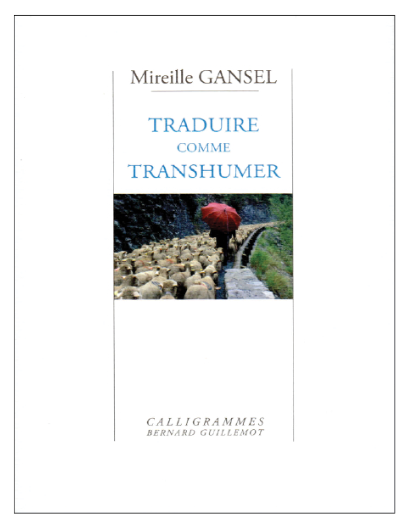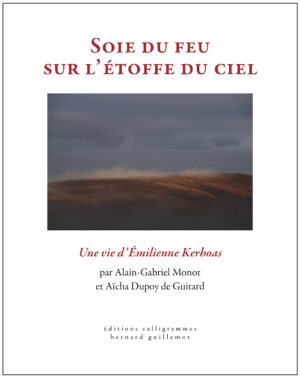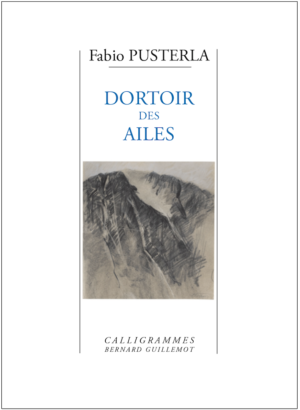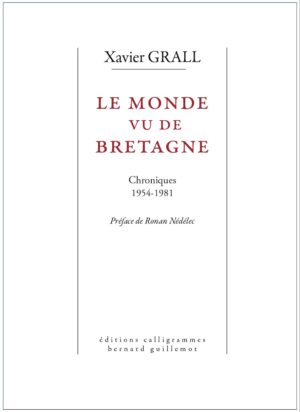« Traduire comme transhumer » de Mireille Gansel
« Je me souviens bien de ce matin de fonte des neiges où, assise à une antique table, sous les poutres noircies, soudain je réalisai que l’étranger ce n’est pas l’autre, c’est moi, moi qui ai tout à apprendre, à comprendre de lui. Ce fut sans doute ma plus essentielle leçon de traduction. »
Pour feuilleter les premières pages, cliquez sur la couverture
18,00€
Un récit autobiographique de la traductrice Mireille Gansel - qui est aussi une réflexion sur l’acte de traduire - dans la perspective roborative de la transhumance.
Préface de Jean-Claude Duclos
96 pages au format 15 x 21 cm
ISBN 978.2.8696.5195.0 / décembre 2012
4e de couverture / photos
« À peine avais-je évoqué ce poète vietnamien avec son inséparable petit sac plein de livres et son rêve un peu fou de le traduire, que René Char me versa alors un deuxième verre de lumière et déjà se levait et revint les mains pleines de poèmes. De sa fine et longue écriture de noirs cyprès penchés sous le mistral, il traça sur les pages de garde des paroles comme une main tendue, et me dit d’embrasser pour lui son frère en poésie.
Je repartis avec ces trésors dans ma sacoche ou plutôt ma « biasse » de berger car cette petite route de Provence me parle de la transhumance : ce grand et long passage des troupeaux vers des terres lointaines. Pour trouver aux saisons venues les plus belles herbes, celles des plaines basses en hiver et des hautes vallées en été – drailles antiques des rencontres et des échanges dans tous les parlers de cette « langue-toit » qu’est le provençal. Ainsi de ces chemins transhumants de la traduction, ce lent et patient passage, toutes frontières abolies, d’un pays à un autre, d’une culture à une autre, d’une langue à une autre. »
» Cette conviction qu’aucun mot parlant de l’humain n’est intraduisible. ».
Les photographies ont été prises par Patrick Fabre en juin 2007 dans les gorges du Bachelard, sur la route du Col de la Cayolle (Alpes-de-Haute-Provence). Le troupeau est celui de la famille Roux (St Martin de Crau) et le berger s’appelle René Alcazar.
Notes de lecture
Andrée Lerousseau, maître de conférences, Lille 3
« Du pouvoir salvateur des mots… »
Traduire comme transhumer qu’introduit la belle préface de Jean-Claude Duclos, retrace le double itinéraire d’une traductrice engagée et de la langue – ou des langues –, « transhumance » qui s’origine dans l’expérience primordiale, et toujours à renouveler, du silence de l’écoute et du partage.
Tout commence par la révélation du père, initiant la petite fille au poids et à la magie des mots. Puis vient la fascination pour la « langue en exil », « sans territoire », pour l’allemand « métissé », rescapé de l’ancien empire austro-hongrois, et qui est aussi la langue « qu’aucune barbarie n’aura pu enténébrer », des membres rescapés de la famille, langue de mémoire venue d’un monde anéanti, dont Mireille Gansel retiendra le mot innig, « profond, intense, fervent ». De ce double héritage devait naître l’extrême vigilance dans la recherche du mot juste, en marge de tout bavardage, et l’étonnante profondeur qui habite ses écrits, ainsi que sa quête incessante, justifiant tous les risques, de ces langues habitées d’une voix humaine, qui résistent à « l’enténèbrement du monde » et à l’enfermement dans la langue de bois. Elle se souvient d’une soirée dans une petite salle du Collège de France où, à l’écoute de Robert Minder, elle fit la découverte du pouvoir salvateur des mots. Elle s’enthousiasme alors pour Brecht et pour le gestus d’une écriture « qui donne à voir le familier dans l’étranger, l’étranger dans le familier », « créant ainsi une hospitalité », et part pour Berlin où elle rencontre l’actrice Helena Weigel, compagne du poète et dramaturge, qui a su si bien « s’en faire l’interprète ». Etape décisive sur son « chemin d’apprentissage », le séjour au Berliner Ensemble, durant lequel elle assiste aux répétitions et aux représentations de la troupe, sera pour Mireille Gansel une « immense leçon de traduction ».
Riche de ces expériences, elle se fait à son tour l’interprète des poètes, pas n’importe lesquels, ceux dont la parole oppose une résistance à l’obscurantisme et aux violences de l’histoire. Solidaire et fermement résolue à faire de la traduction « une main tendue entre des rives sans pont », elle fait la connaissance de Reiner Kunze, écrivain et poète de la RDA et lui-même traducteur, dont elle partage le combat contre la barbarie aux multiples visages. Elle retrouve avec lui cette « terre des confins » appartenant à son histoire, « territoire des confluences entre [les] langues ». Ne reculant devant aucun danger, elle n’hésite pas à emprunter les « chemins de traverse » conduisant vers des lieux extrêmes : dans le Nord Vietnam ravagé par le napalm et les bombardements des B52, elle fait avec les poètes ce rêve fou « d’opposer à la déclaration de Mac Namara ‘‘on réduira ce pays à l’âge de pierre’’ le témoignage d’une culture plurimillénaire », et travaille avec eux à la rédaction d’une anthologie en français de la littérature vietnamienne. Une autre expérience de ces territoires de l’extrême sera sa traduction, parue en trois volumes chez Verdier, de l’œuvre poétique de Nelly Sachs. Les chapitres qu’elle consacre à la poétesse comptent parmi les pages les plus belles et les plus profondes jamais écrites sur elle, et si la traduction de Mireille Gansel surpasse toutes les autres, c’est parce qu’elle a su percevoir et rendre « le souffle de la langue hébraïque » qui traverse cet allemand, ce respir cher à Claude Vigée et Henri Meschonnic, puisé à la traduction de la Bible par Buber et Rosenzweig, et les étincelles du Zohar qui parfois font tressaillir la langue. Dans un chapitre lumineux, elle nous dévoile « les quatre clefs » (Esther Starobinski-Szafran) de l’œuvre, héritées de la tradition de l’exégèse juive, et qui sont aussi celles de sa propre traduction : Pchat, Remez, Drach, Sod.
Au fil des pages, il nous vient à l’esprit la question qui traverse tous les écrits de Mireille Gansel : « A quoi bon les poètes en temps de désastre ? » (cf. sa postface à Exode et métamorphose… de Nelly Sachs, Verdier, 2002), formulation radicale, due au surgissement d’une barbarie protéiforme, de l’interrogation de Hölderlin : « A quoi bon les poètes en temps de détresse ». Ce questionnement est sans nul doute au fondement de cette « transhumance » qui apporte une réponse : afin qu’advienne à nouveau la parole humaine. Que celle-ci ne soit pas le privilège exclusif des poètes, c’est ce que montre le voyage entamé par la traductrice à travers les Alpes, sur les traces de l’ethnologue Eugénie Goldstern, née à Odessa en 1884, réfugiée à Vienne en 1905, et assassinée à Sobibor en 1942. Tandis qu’elle parcourt les écrits d’Eugénie Goldstern (parus en français aux éditions du Musée Dauphinois), Mireille Gansel fait « l’apprentissage d’un humanisme qui part du particulier le plus humble pour interroger un universel des quêtes de l’homme dans le temps et l’espace ». Ce sont ces mêmes quêtes qui la poussent sur les « chemins transhumants de la traduction », sur ces « chemins fragiles » (Reiner Kunze) dégagés par ceux dont le premier acte de résistance fut de se mettre à l’écoute, qui tracent pour le lecteur un parcours initiatique en direction d’une humanité vraie faite de partage, d’humilité et d’hospitalité réciproque, à une époque où ces mots, qui peuvent parfois faire figure d’anachronisme, sont pourtant seuls porteurs et bâtisseur d’un avenir. A chacun de « se faire l’interprète » et le relais de cette ultime révélation qui clôt l’avant-dernier chapitre, le dernier invitant déjà à de nouvelles transhumances : « Je me souviens bien de ce matin de fonte des neiges où, assise à une antique table, sous les poutres noircies, soudain je réalisai que l’étranger ce n’est pas l’autre, c’est moi, moi qui ai tout à apprendre, à comprendre de lui. Ce fut sans doute ma plus essentielle leçon de traduction ».